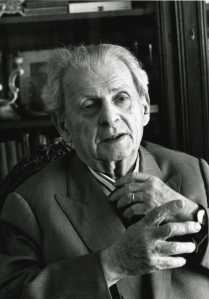Toutes les modes ou névroses de
l’époque sont passées au crible: la vogue du corps, l’hédonisme
triomphant, la méditation transcendantale, le bouddhisme et le
dalaï-lama, le refus de la souffrance et la peur de la mort, les
idéologies gauchisantes, Internet… même la météo! Ne vous battez pas, il
y en aura pour tout le monde… «Le bonheur, s’emporte le séducteur, ne
constitue pas seulement, avec le marché de la spiritualité, la plus
grande industrie de notre époque, il est aussi et très exactement le
nouvel ordre moral. Rien d’étonnant si la dépression s’installe dès que
cet hédonisme est un tant soit peu malmené par les réalités de la vie.»
Et de s’en prendre aux marchands de
plaisir ainsi qu’aux grands prêtres du devoir de banalité. Après un
brillant développement consacré au vide laissé tant par l’effacement du
paradis chrétien que par la sécheresse normative des Lumières, la
démonstration s’empare de notre époque. «Bonne et mauvaise nouvelle du
retrait divin, écrit l’auteur. Chance pour l’indépendance humaine de se
déployer sans tutelle mais aussi poids du quotidien qu’il faut porter à
bout de bras… Au sublime médiéval succède le trivial moderne, au grand
absolu, le petit relatif. Terrible vertige d’un homme soudain délesté de
ses entraves et qui subit moins un désenchantement qu’une
désorientation; il se retrouve libre mais pygmée… Avec cet
affranchissement naît aussi la banalité, c’est-à-dire l’immanence totale
de l’humanité à elle-même.» Le résultat en est l’émergence d’une
transcendance «horizontale», qui se traduit par une recherche
perpétuelle du plaisir. Ce fameux plaisir, qui emprunte deux voies
principales: «La griserie, quête éperdue de l’intensité, ou la
grisaille, jouissance paradoxale du fade sous les mille formes qu’il
peut prendre.» Nous voici au cœur du livre.
Pour ce qui est de la griserie, sus à Gide, qui lance le sensualisme militant, futur credo de 1968, dès la publication des Nouvelles Nourritures terrestres,
en 1935! «Une somme de bonheur est due à chaque créature, écrit le
grand André, selon que son cœur et ses sens en supportent. Si peu que
l’on m’en prive, je suis volé.» Voilà le drame qui se noue, selon
Bruckner. Il suffit que je ne jouisse pas tout mon saoul pour que je
rate ma vie. Ce qui a deux conséquences tragiques. Premièrement, le
malheur commence à l’instant même où cesse le bien-être. Deuxièmement,
puisque l’enchantement dépend de notre seule jouissance, nous nous
estimons coupables de nos revers. Puis vient la grisaille. «Je connais
un Anglais, disait Goethe, qui avait déjà tout compris à ce qui se
tramait, qui s’est pendu pour ne pas avoir à renouer sa cravate chaque
matin.» Bruckner, avec une sincérité déchirante, qui trahit l’expérience
vécue, décortique nos cortex. «Le quotidien compose un néant agité: il
nous épuise par ses contrariétés, nous dégoûte par sa monotonie. Il ne
m’arrive rien mais ce rien est encore trop: je m’éparpille en mille
tâches inutiles, formalités stériles, vains bavardages qui ne font pas
une vie mais suffisent à m’exténuer. C’est cela qu’on baptise le stress,
cette corrosion continue à l’intérieur de la léthargie qui nous
grignote jour après jour.» Rosolino Coella nous avait déjà prévenus: «La
vie s’en va par le cerveau et les nerfs…» Pour combattre cette vacuité,
on recourt à mille expédients. C’est là que Bruckner se montre le plus
cruel. S’inquiéter de la météo – «pédagogie de la diversité minuscule»
(s’il ne nous arrive rien, il arrive au moins qu’il pleuve ou qu’il
vente) – tomber malade – avoir quelque chose à dire sur soi qui sorte de
l’ordinaire, «qui nous pourvoie d’une histoire» – céder à l’envie ou à
la jalousie sociale – pour se convaincre qu’il y a des ennemis et, donc,
un enjeu – tels sont les revers de notre civilisation d’abondance. Mais
l’essayiste réserve ses meilleures flèches aux souffleurs de fadaises,
ceux qui vantent les sucreries spiritualisantes dont tant d’esprits
faibles sont friands. «La thérapie par le sourire, ricane Bruckner,
c’est l’avantage incontestable, en termes de marché, des bouddhistes sur
les chrétiens.»
Voilà pourquoi le Bouddha séduit
désormais les riches de l’hémisphère Nord, tandis que le Christ console
encore les pauvres des tropiques. Dure vérité, qui fera mal à nombre
d’intellos parisiens fascinés par les vapeurs d’encens, les coups de
cymbale et le zen tibétain. Il y a plus vache encore. A destination des
gentils philosophes qui distillent de la sagesse sous forme de
best-sellers. «Ce qui rend les traités du bonheur en général si plats,
fouette le pamphlétaire, c’est qu’ils délivrent un seul et même message:
contentez-vous de votre sort, modérez vos envies, désirez ce que vous
avez et vous aurez ainsi ce que vous désirez. Sagesse aussi résignée
qu’insipide…» Nul n’est cité, mais, à propos de «consolateurs
officiels», le lecteur paraît invité à refermer le Petit Traité des grandes vertus, d’André Comte-Sponville, ou bien La Sagesse des Modernes, dû au même auteur associé à Luc Ferry.
Conclusion? «On rate le bonheur à
force de croire qu’il n’est pas le bon.» Qu’on nous laisse donc être
nous-mêmes, drôles ou tristes selon les jours et les humeurs, car «il
n’y a rien de pire que ces gens éternellement gais, en toutes
circonstances, qui ont accroché une grimace radieuse à leur face». Il y a
peut-être bien du Pascal dans ce Bruckner…